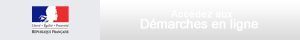Généralités :
Lapierre granitique de Kersanton¹, très recherchéejusqu’en 1945, a fait vivre plusieurs centaines d’ouvriersde la commune ou des localités environnantes. Au nombre dequatre, les carrières ont fourni la pierre pour de nombreuxphares de la région, pour des églises et pour desbassins des ports de Brest et du Havre.
Aprèsla première guerre mondiale, elle servit égalementà la construction de monuments commémoratifs ou d'édificesdivers².
Letransport se faisait par mer ou par rail. Tantôt des charrettestransportaient la pierre, jusqu’à la gare de Daoulas,tantôt des bateaux remontaient le Camfrout à maréehaute et venaient charger la "marchandise" aux abordsde la cale Jeanne d’Arc.
¹ La Kersantite n’est en réalité pas ungranit, car dépourvue de quartz mais un lamprophyre richeen biotite (mica noir) qui lui confère sa teinte noire sicaractéristique. C’est la seule roche au monde dontle nom dérive d’un toponyme breton.
²Tel le calvaire des bretons de Bizerte.
Les carrières d’extraction de l’hôpital-Camfrout: Huit siècles d’utilisation de la kersantite Six carrièresimportantes, dont trois côte à côte àmoins de 600 mètres du centre bourg au lieu dit Rhun-Vraz,une multitude de «trous ». Exploitées épisodiquement,elles ont été intégrées au territoirecommunal de L’Hôpital-Camfrout lors de la refonte deslimites administratives de 1946.
Les carrières de L’Hôpital-Logonna ont fourni,avec celles de la pointe du château à Logonna de Rosmellecà Daoulas et de Kersanton à Loperhet ,du XIV èmesiècle jusqu’aù milieu du XX ème siècleune part non négligeable de la matière d’œuvrede la statuaire bretonne. Les premières utilisations conséquentesremontent à l’ouverture du chantier de l’abbayede Daoulas, au XII ème siècle (1167-1179). L’utilisationde la kersantite dans l’architecture religieuse et l’artsacré de la Bretagne prend son essor au XIV ème siècleavec l’ouverture du chantier ducal (Jean V/FrançoisI) de la collégiale du Folgoët. L’apogéede son emploi dans ce registre se situe aux XV ème et XVIème siècles. La kersantite constitue vers cette époquela pierre de prédilection des plus célèbresateliers de sculpture de la région (ceux de Roland Doréet Julien Ozanne par exemple).
L’extractionet la taille se poursuivent aux siècles suivants (XVII etXVIII ème) en fonction des commandes. Les travaux de restaurationconstituent l’essentiel des commandes.
Aucours de la seconde moitié du XIX ème siècleet de la première moitié du XX ème sièclela demande en kersantite pour les ouvrages d’art (viaduc, phares,tunnels ferroviaires) et pour la maçonnerie entraîneune reprise de l’utilisation et par voie de conséquencede l’extraction. Les commandes de monuments aux morts et demonuments funéraires par les communes et les particuliers,entre les deux guerres permettent de maintenir l’activité.
Lefonctionnement :
Detype artisanal, identique à quelques variantes prèsd’une carrière à l’autre. Une zone d’activitépolarisée sur trois espaces :
-Le «trou », zone d’extraction d’une profondeurvariable allant de 5 à10m, mais pouvant atteindre 25 à30m.
-Le chantier de taille, où les opérations sont essentiellementmanuelles.
-Les quais d’embarquement, à un ou deux niveaux pourtenir compte des hauteurs d’eau.
L'environnementsocial :
Audébut du siècle, la main-d’œuvre employéesur les principaux sites est évaluée à quelquescentaines de personnes (trois , quatre cents, en fonction de lademande, de la saison). Chaque carrière emploie de vingtà trente personnes en permanence, l’une d’entreelles a même pu compter jusqu’à deux cent cinquanteemployés.
Par la suite, les chiffres plafonnent à un niveau nettementplus modeste, quelques unités, juste avant la fermeture desprincipaux sites dans les années 40/50.
Leschiffres de la population de L’Hôpital-Camfrout semblentsuivre d’assez près les fluctuations de l’activitédes carrières.
Le travail est pénible, exposition aux intempéries,nombreux accidents (écrasements, éclats de pierres,fractures, maladies pulmonaires), mal rémunéré(rémunération à la tâche ou àla journée). Un mouvement syndical se met en place de manièreéphémère de 1898 à 1903. Il aboutità deux grèves axées sur des revendicationshoraires et salariales.
Le salaire, un des plus bas de la profession, oblige l’ouvrierdes carrières à recourir au crédit permanentdans les commerces du bourg et, bien souvent, à exercer uneautre profession dans les périodes de creux (recours àla pêche ou à l’agriculture).
ghghghghghghghg
Lagestion des carrières :
Ils’agit d’une gestion en direct par le propriétaire-exploitantou parfois par un contre-maître représentant le propriétaire,souvent entrepreneur de T.P. ; ou de maçonnerie résidanten ville.
CarrièreOMNES
La plus à l’Est du site des carrières, elle aconnu de nombreux problèmes d’infiltration d’eau,rachetée par des marbriers dans sa dernière phased’exploitation, elle ferme définitivement en 1946.
CarrièreDERRIEN
Propriétaire actuel M. SANQUER, elle est exploitéejusqu’en 1880 par M. Raguet, entrepreneur de T.P. àBrest. Elle est achetée par M. DERRIEN qui l’exploiteavec l’aide de ses deux fils. Elle compte 19 ouvriers en 1893,27 en 1893, 35 en 1914. Elle dispose d’une grue mécaniquepour l’extraction des blocs, de Wagonnet pour leur déplacementd’une forge pour l’entretien des outils et d’un quaid’embarquement pour l’acheminement des pierres par voied’eau. Fermée en 1960, elle est rachetée parM. SANQUER en 1974, celui-ci avec l’aide de son fils s’efforcede la moderniser et d’y maintenir une activité baséesur la taille des cheminées et linteaux pour la construction.Elle cesse toute activité en 1984.
CarrièreCORRE
Du nom de son propriétaire, elle sera géréependant longtemps par des contre-maîtres. Le nombre d’employésse chiffre à 25 au plus fort de son activité L’extractiondes pierres se fait par wagonnets tirés par des treuils.Elle dispose d’une forge, de bureaux d’administrationet de quai d’embarquement. En 1946, trois ans avant sa fermeturedéfinitive, elle produit cinq cent tonnes de pierres paran.
CarrièresLABOUS
Date de démarrage de l’extraction des pierres sur cesite, dès le XVII ème siècle (on y a retrouvédes coins métalliques datés de 1620) ? Elle est achetéepar Mr LABOUS en 1905, elle compte 12 ouvriers de 1918 à1939. Après 1941, commence une période de déclinqui s’achève par l’arrêt définitifde l’exploitation en 1956.
Carrièrede GERVADEN
Elle fut l’une des plus importantes par le nombre de ses employésau début du XX ème siècle. (250 personnes,dont 50 femmes, fait assez rare.) Elle est propriétéd’un entrepreneur de T.P. de BREST, elle est géréepar un contre-maître jusqu’en 1926. Elle utilise la forced’une machine à vapeur pour le fonctionnement d’unportique et d'un palan utilisés pour l’extraction etle transport. Le chantier de taille se situe ici directement surle «trou ».